Rencontre avec Laurence Biberfeld
Grain d'hiver est paru le 16 août. Après deux ans de silence, rencontre avec une autrice qui ne concède rien.

Son précédent livre, Malencontre, destiné aux jeunes lecteurs et aux autres, lui a valu le grand prix de la Société des Gens de Lettres. C'était en 2022. Il aura donc fallu patienter deux longues années pour retrouver sa langue de rage et de feu. Mais quel retour ! Car si elle aborde les motifs qui lui sont chers – les violences familiales, sociales, administratives, la terre ravagée, l'amour inconditionnel, l'exil, la variabilité humaine - c'est une autrice au summum de sa force qui nous propose un roman bâti comme une cathédrale autour d'une héroïne splendide, Gafna.
A ceux qui la connaissent, ce seront des retrouvailles heureuses. Aux chanceux qui ne la connaissent pas encore, une découverte magnifique.
Rencontre.
Tu commences à publier des livres dans les années 2000, à la Série noire. Viendront ensuite un Poulpe, des romans noirs chez Au delà du raisonnable, à la Manufacture de livres dans la très belle collection Territori pilotée par Cyril Herry, puis chez In8. Du noir, du noir, du noir. Pourquoi ce tropisme ?
C'est le registre qui me convient le mieux. Il y a dix-huit ans on séjournait au Portugal, et à Coimbra on avait vu des inscriptions sur les murs qui disaient : aborto : o crime esta na lei (le crime est dans la loi). C'est une façon de remettre la loi à sa place fluctuante : elle peut servir ou desservir les droits. Ce qui fait que je m'intéresse à toutes les zones grises – lorsqu'il y a certains droits mais pas tous - et les zones opaques – lorsqu'il n'y a aucun droit - des sociétés. Lemlem [une jeune Erythréenne sans papiers, personnage de Grain d'hiver] est dans une zone grise : elle ne peut guère être expulsée, mais ne peut pas travailler et peut être enfermée en Centre de Rétention Administrative. Quand on crée des zones grises et des zones opaques, on crée une sorte d'antichambre où les règles ordinaires entre humains ne s'appliquent plus. L'impunité suscite le crime. Et dans notre société de droit, il existe d'innombrables interstices de non droit. La prison en est un, ainsi que les CRA ou les zones de transit. La clandestinité en est un. Le handicap aussi. Et le couple, et la famille. Je mets en scène ces zones grises, ou ces zones opaques. C'est ça pour moi le roman noir.
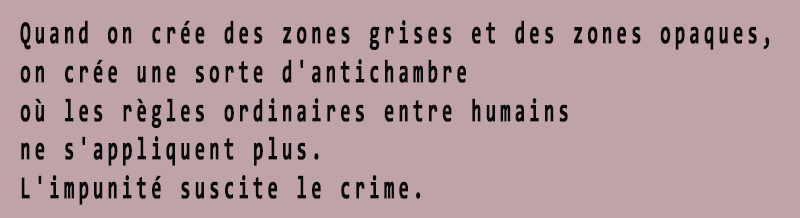
Vois-tu une évolution dans ta propre écriture ? Ta manière de construire les personnages ? De notre point de vue, ta radicalité politique, anarchiste, s'est progressivement commuée en puissance romanesque. Le discours qui pouvait être sensible dans les premiers textes a laissé la place à un point de vue sur le monde, d'autant plus efficace qu'il « fait monde ». Souscris-tu à cette analyse ?
Oui, c'est probablement un effet du vieillissement d'avoir une vue plus globale et plus dynamique des choses. Au début j'étais littéralement étouffée par un sentiment d'injustice assez insupportable. Maintenant je suis en colère, toujours. Mais ça ne m'étouffe plus. Je reste anarchiste dans la mesure où je pense réellement que le pouvoir est maudit, comme le disait Louise Michel, mon instit préférée. Il n'existe pas de pouvoir qui ne se manifeste par l'abus de pouvoir. Disons qu'aujourd'hui il me semble plus efficace de montrer que de démontrer. À mon échelle, mettre en scène des personnes totalement dénuées de pouvoir dans toute leur créativité, leur intelligence et leur solidarité, est plus intéressant. Déjà ça me permet de mettre en scène des femmes et des enfants. Des vieilles, des bébés. Des précaires, des étrangers. J'ai eu très jeune une période d'extrême précarité et je me suis retrouvée dans ce monde, qu'une de mes filles connaît toujours. C'est dur, mais c'est aussi riche, chaud. Une fois, il y a quelques années, on s'est retrouvés à la déchetterie en même temps qu'un couple de vieux manouches qu'on connaissait, lui est mort depuis. Il nous racontait la vie quand ils étaient encore itinérants, comment ils dormaient gosses dans les fossés, ils se réveillaient avec du givre sur leurs fringues, dans les herbes. Je lui ai dit oh là là, ça devait être dur, et il m'a répondu avec des étoiles plein les yeux : non mon petit, ça c'était la vie.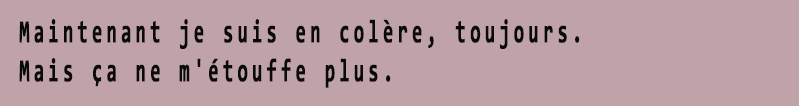
Alors qu'elle a progressivement déserté le champ du noir au profit d'une littérature de la sensation, avec l'essor du thriller, la critique sociale reste au cœur de tes livres. Cette fidélité est-elle naturelle de ton point de vue ? Nécessaire, volontaire, consciente ? Dirais-tu qu'un écrivain reste toujours politique ?
Un écrivain est toujours politique, toute littérature est politique. Il ne s'agit pas seulement du sujet traité, mais de la façon dont le récit intègre ou pas, donne une vue étroite ou large. Qui parle ? Qui s'exprime ? Qui est un sujet, un objet ? Combien y a-t-il de registres ? Tout ça est politique. C'est vrai que j'accorde de plus en plus d'importance à la construction. Qu'est-ce que je veux rendre visible ? Il ne faut pas se planter. Mon dernier éblouissement en date est Lucia Berlin, que je viens de découvrir, dans une sorte d'auto-fiction en nouvelles. Rien n'est plus éloigné de la politique, mais rien n'est plus amoureux de l'humanité défaillante, rien n'est plus éloigné de l'idée de mettre au pas, venger, punir. Une littérature qui se voudrait émancipatrice commencerait par faire entrer tout le monde dans ses personnages, à multiplier les points de vue. Est-ce que ça doit être conscient ? Nous avons besoin de récits. Dans un récit sommaire, le méchant est à exécuter, le lecteur est tenté par ce que j'appellerais le syndrome Dexter : on peut être sadique avec les sadiques. On peut haïr et souhaiter détruire, quoi de plus simple, de plus gratifiant ? C'est un récit de défoulement qui ne pousse pas trop à s'interroger, un peu comme certaines opinions. Mais il y a des livres-talisman, qu'on garde parce qu'ils nous aident à lire le monde. La littérature a aussi cette fonction, nous faire rencontrer plus de gens que nous pourrions en rencontrer dans une simple vie, et nous laisser immensément plus de choix... politique.
Malencontre a reçu le Grand prix jeunesse de la SGDL, après avoir été sélectionné pour le prix Pépites. Pour ton premier livre « jeunesse », qualification qui du reste a fait débat, c'était une surprise... Mais prix ô combien mérité car il s'attache à distinguer les qualités proprement littéraires et l'audace d'écriture, que Malencontre incarne parfaitement. Ce prix fut-il pour toi une surprise ? A-t-il modifié quoi que ce soit dans ton rapport à l'écriture ? Au lectorat ?
Pour une surprise oui c'était une surprise, car je suis une écrivaine très secondaire dans le paysage médiatique. J'étais vraiment stupéfaite. En même temps c'est rassurant, ça veut dire que même un petit roman d'un petit éditeur peut être remarqué. C'était une expérience de rencontrer cette vénérable institution, j'y suis d'ailleurs retournée cette année pour participer au jury jeunesse. Le lectorat m'a beaucoup émue, que ce soit celui rencontré aux Pépites ou lors du prix Tatoulu – [Malencontre a aussi reçu le Prix Tatou noir porté par l'association Tatoulu]. J'étais étonnée car lorsque j'écris, je ne pense pas, sincèrement, à mon lectorat. Bien sûr qu'écrire c'est offrir un bon gros pan de soi chaque fois, comme tous les boulots artistiques, c'est un peu une bouteille à la mer, mais au moment où je suis sur l'écriture, je ne pense qu'à l'écriture, et beaucoup plus à mes personnages qu'à ceux qui vont me lire.
Laurence, tu signes aujourd'hui un fabuleux roman intitulé Grain d'hiver, qui tient debout par la force d'une femme, Gafna, véritable pilier d'une famille décomposée, malmenée par les violences.
D'où vient ce personnage ? Qu'incarne-t-elle ? Qui te l'a inspiré ?
J'ai une théorie de sorcières bienveillantes dans mon imaginaire, j'ai moi-même l'impression d'en trimballer une car je partage deux ou trois choses avec Gafna : je cueille, j'aime les bébés, et j'endure volontiers la solitude. Gafna n'a pas su comment protéger sa fille, si bien qu'elle l'a surexposée, et pendant tout le roman elle s'efforce de réparer, et plus que de réparer, de construire. La personne qui a été la plus importante pour moi, la plus soucieuse de moi dans ma famille, était ma grand-mère paternelle. C'était quelqu'un d'aimant et de solide dans un chaos général. De mon arrière-grand-mère maternelle j'ai souvenir d'avoir été dans son lit, blottie dans sa chaleur, tandis qu'elle disait les contes de Perrault, qu'elle connaissait par cœur. J'ai eu pas mal d'amies nettement plus âgées que moi. J'en ai une particulièrement avec qui je bosse pour un journal féministe et libertaire qui s'appelle Casse-rôles, Solange, un pilier, toujours debout et l'œil vif à pourfendre la connerie humaine, à 80 berges. Gafna emprunte à toutes ces sorcières, mais j'ai forcé le trait. Les vieilles femmes ont tout connu. Souvent les vieux ont eu des carrières mais les vieilles ont eu des vies, c'est un truc d'assignation, mais cela fait que leur palette d'expérience est beaucoup plus large et riche. Quand elles sont fortes et bienveillantes, qu'elles ont essuyé tous les grains, elles ont une énorme richesse existentielle.
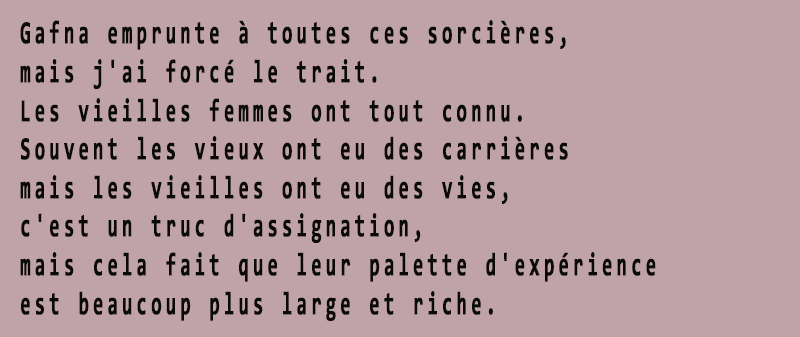
Tu relies les désastres collectifs du XXème siècle aux violences policières sur les réfugiés en 2024. Pourquoi établir ce lien ?
Il me paraît évident, ce lien. L'obsession raciale est un point commun entre cette époque et la nôtre, où les musulmans ont plus ou moins remplacé les juifs et sont la cible des discours de haine les plus délirants. Le racisme est complètement désinhibé. Il est devenu structurant dans la vision du monde d'un tiers de la population française, mais aussi italienne, hongroise, polonaise, néerlandaise, etc. et appelle de nouveau à de potentiels carnages. On a déjà eu une période fasciste en Europe, et il semble qu'on soit dans une autre. Ni Orban ni Meloni n'ont fermé les frontières, mais la grille raciale permet de maltraiter et surexploiter les plus précaires, les Français non blancs, les immigrés, les clandestins, sans lesquels des secteurs entiers couleraient. Donc ces situations ne se calquent pas, mais il y a un phénomène d'écho. La police harcèle, terrorise et parfois tue, c'est un fait, dans les quartiers, dans les campements de réfugiés, de gens du voyage. Elle fait ce pour quoi on la missionne au plus haut sommet de l'État. Cette police qui était, il y a quarante ans, majoritairement socialiste, est devenue majoritairement d'extrême-droite, avec tout ce que ça entraîne du point de vue de la violence et du racisme.
De Péter les boulons à Il nous poussait des dents de loup, de Panier de crabes (coll. Polaroid) à Malencontre (roman ado) et Grain d'hiver, l'idée de « famille » est toujours au centre de tes livres. Elle est le siège de douleurs morales infinies – on songe à la position de la mère dans Panier de crabes – elle est aussi le lieu du seul espoir humaniste possible, du dernier quartier d'empathie qui résiste à l'envahisseur que sont les violences sociales, lorsqu'il s'agit d'amour inconditionnel – ici on pense à Luiza et Marco dans Malencontre - ou des familles qu'on s'invente. C'est quoi, pour toi, la famille ? Quelque chose dont on hérite, et avec lequel on doit s'arranger, se déterminer, qu'il s'agisse de couper les amarres ou de s'engager corps et âme ?
C'est un rêve tenace, la famille. De fait, c'est le lieu de toutes les oppressions, des violences les plus extrêmes, les enfants y sont soumis à l'arbitraire des adultes. C'est aussi le lieu de plus intense et longue intimité, de plus long côtoyage. Et les lignes bougent, tout le temps. Car les enfants grandissent, les parents évoluent, vieillissent, les rapports de force changent. C'est aussi là que se manifestent les solidarités les plus étroites, les plus solides. On hérite forcément d'une histoire, mais on n'est pas obligé de se couler dedans. On peut déserter. Dans Grain d'hiver on a une lignée qui n'est pas de sang, et quand elle commence à être de sang, tout se gâte. En tant qu'enfant je n'ai pas une bonne expérience de la famille, je me classe parmi les déserteuses, j'ai d'ailleurs foutu le camp très jeune et sans bagage. Mais j'ai fondé une famille. J'ai été plutôt heureuse, malgré la pauvreté, la précarité et les déménagements incessants, plus heureuse que mes enfants à vrai dire. Le dénominateur commun à toutes les familles, c'est que parents et enfants ne se choisissent pas.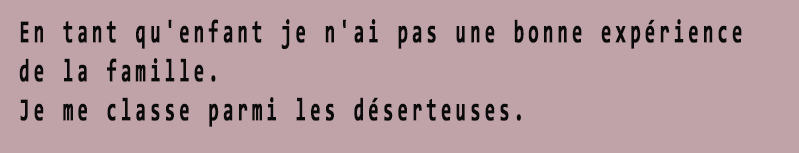
Dans ce livre, la nature ou la Terre – selon comme on la désigne - est un personnage à part entière. Souffrant, comme d'autres personnages, de la violence des hommes, elle tempête, s'exprime, produit des événements qui infléchissent l'aventure des personnages. Elle nous offre de splendides moments de lecture, au passage, qu'il s'agisse d'une baignade dans un champ d'avoine, de traversées dans les vignobles, d'une tempête homérique... Le roman noir n'est plus forcément un roman urbain ?
Non ! En ce qui me concerne la moitié de mes romans sont non urbains. Même si on se place du point de vue social, les premières industries, filatures et mines, se sont faites dans des lieux très éloignés des centres urbains. Et aujourd'hui les luttes sociales les plus âpres de ces dernières années, pour le partage de l'eau, pour arrêter les grands projets inutiles, se déroulent loin des villes. On a littéralement des scènes de guerre dans les champs et les bois. Les espaces ruraux ont toujours été des grands espaces de luttes sociale, il n'y a qu'à voir la révolte des vignerons dans le sud-est, qui a failli avoir la peau du gouvernement au début du XXe siècle. Et tout un pan de la littérature noire, sociale, se déroule hors des villes, dans des petits bleds, ou en campagne. Mac Bain se concentre sur la ville, mais pas Thompson !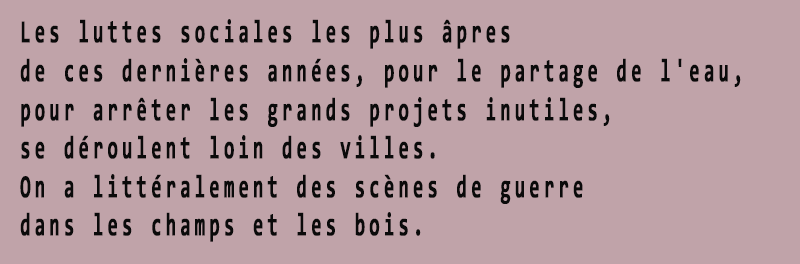
Un message pour les futurs lecteurs (chanceux !) de Grain d'hiver ?
Ce livre est noir, comme tout ce que j'écris, mais pas désespérant. Vous allez vous promener entre campagne et ville, entre hier et aujourd'hui, et même entre les morts et les vivants. J'espère de tout mon cœur qu'il vous fera du bien !
Découvrir Grain d'hiver
